
Accès à la rubrique « Autogestion de la santé »
Consultez les mentions légales (RCP) des médicaments disponibles dans votre pays
![]() Médecine d'Afrique Noire
Médecine d'Afrique Noire
Consulter la revue
![]() Médecine du Maghreb
Médecine du Maghreb
Consulter la revue
![]() Odonto-Stomatologie Tropicale
Odonto-Stomatologie Tropicale
Consulter la revue
Restez informés : recevez, chaque jeudi, la lettre d'informations de Santé Maghreb.
Accueil > Santé Maghreb au Maroc > Revue de presse
L'Opinion | Maroc | 29/04/2006
Entretien avec Jamal Bellakhdar, pharmacien chercheur en ethnopharmacologie
Jamal Bellakhdar pharmacien, docteur en sciences de la vie et chercheur en ethnobotanique et éthnopharmacologie, vient de publier un nouvel ouvrage « Plantes médicinales au Maghreb et soins de base, précis de phytothérapie moderne » (Editions Le Fennec, Casablanca).
Il s’agit d’une monographie, première du genre, avec sélection de 144 plantes réputées pour leurs vertus médicinales dans la tradition de soins au Maghreb et dont les travaux de recherches scientifiques ont confirmé, sans l’ombre de doute, leurs vertus thérapeutiques.
Dans l’entretien suivant l’auteur nous parle justement de ce travail qui est le résultat d’une vie de communauté avec les plantes, avec tout ce que cela suppose comme connaissance dans la proximité à travers les pays du Maghreb Maroc, Algérie et Tunisie. Le propre de cette démarche est d’être en même temps inscrite dans le progrès le plus récent de la science et la pratique millénaire depuis l’antiquité d’un patrimoine culturel spécifique. L’auteur qui vit actuellement à Metz (France) a mené une vie de travail passionnant ponctuée de plusieurs ouvrage dont « Médecine traditionnelle et toxicologie ouest-saharienne en 1978 (Prix du Maroc en 1979 des sciences et des mathématiques), « Substances naturelles à usage pharmaceutiques et développement économique au Maghreb » (1989), « Tissint une oasis du Maroc présaharien - monographie d’une palmeraie du Moyen Dra »(1992), « Maghreb : artisans de la terre » (2002), « Le Maghreb à travers ses plantes » (2004). Jamal Bellakhdar avait reçu le Prix du Maroc en 1997 pour son livre « La Pharmacopée marocaine traditionnelle - médecine arabe populaire et savoir populaire ». La démarche d’écriture de Jamal Bellakhdar est aussi d’un écrivain fin lettré placé, comme il le dit lui-même, au confluent de la botanique, la pharmacologie et l’anthropologie.
Q : En lisant votre livre où vous parlez d’une tradition, d’un patrimoine millénaire de soins par les plantes qu’aujourd’hui la science la plus pointue reconnaît et confirme, on ne peut manquer de se rappeler d’anciennes lectures comme « La Sorcière » de Michelet ou encore des écrits sur Paracelse par Alexandre Koyré notamment, Paracelse dont on disait qu’il puisait sa science non pas dans les livres mais chez les vieilles femmes qu’on appelait sorcières et que l’Eglise chrétienne mettait au feu. Il semble que ce qui est important c’est de parler du rapport entre le patrimoine écrit laissé par des auteurs anciens et le patrimoine oral en recul aujourd’hui, et ce dernier avec les nouveaux chercheurs. Pour écrire un livre sur les plantes médicinales spécifiques du Maghreb, quelles sont donc les sources entre le livresque et le terrain ?
R : Ce qu’il est important de souligner à ce sujet, comme vous l’évoquez d’ailleurs dans votre question, c’est que la pharmacopée marocaine s’est nourrie à deux sources : une tradition antique, fixée par écrit dans d’anciens traités, et un savoir plus récent, né de l’expérience acquise localement, en matière de soins, par les populations, s’enrichissant ou s’appauvrissant de manière continue et transmis oralement, par voie familiale ou initiatique, d’une génération à l’autre.
La première source, la tradition écrite, est constituée par les corpus de savoir académique et doctrinaire que les savants arabes nous ont laissés, savoir qui est une compilation des connaissances acquises par les civilisations anciennes (notamment ce qu’ils purent apprendre des médecines antiques gréco-romaine, indienne, et proche-orientale), compilation augmentée des connaissances acquises chez les populations de l’Arabie et dans les territoires de l’Ancien Monde que les Arabes ont conquis ou visités, ce qui représente en quelque sorte leur apport propre à la science des remèdes.
La seconde source est l’ensemble des procédés empiriques que mettent en œuvre les populations, avec des résultats plus ou moins heureux, pour soulager leurs souffrances, et qui correspondent d’une certaine manière à leur génie propre, à leur capacité d’innovation.
La pharmacopée populaire d’aujourd’hui est donc une combinaison désordonnée de savoirs issus de ces deux sources, à laquelle viennent s’agréger des croyances au magique et au sacré portées à la fois par l’Islam et le fonds païen de l’âme berbère, ainsi que des infiltrations provenant de l’animisme noir ou de la kabbale hébraïque et même, parfois, des emprunts faits à la pharmacie moderne. Il en résulte aujourd’hui une thérapeutique traditionnelle locale dans laquelle le signe coexiste avec la chose, la substance avec le rituel, en une juxtaposition étonnante de type mosaïque.
La transmission du savoir médical académique s’est faite pendant longtemps dans des universités (jâmi’a) et des écoles supérieures (medersa) d’un maître à ses disciples. L’enseignement universitaire de la médecine à la Qarawiyine de Fès et dans les medersas de Marrakech, Fès, Tétouan, Salé, Taroudant, les cours dispensés dans les nombreuses zaouïas clairsemées à travers l’empire, d’Ouezzane à Smara, couvrant ainsi la presque totalité du territoire, tout cet enseignement se maintint, quoique déjà très affaibli, pratiquement jusqu’à la survenue du régime colonial, au début du XXe siècle. Dans la collection des manuscrits marocains du Maréchal Lyautey (Bibliothèque du Château de Thorey, France), on peut voir un diplôme de médecin délivré à la Qarawiyine en 1893 qui témoigne bien de la réalité de ce courant d’enseignement académique. L’examen des inventaires des bibliothèques des zaouïas et des medersas, établis pendant la période du Protectorat, donne lui aussi, au vu du nombre considérable de livres de médecine qui y sont cités, une idée de l’importance de cet enseignement. Autrefois les bibliothèques personnelles des praticiens comptaient un nombre considérable d’auteurs : Avicenne, Ibn Zohr, Ibn Tofaïl, Ibn Beklarech, Ibn Al-Baytar, Kuhin Al-’Attar, Daoud Al-Antaki, pour ne citer que ceux qui furent les plus consultés dans l’Occident arabo-islamique.
Malheureusement, de nos jours, ne subsiste plus que la tradition orale, ce qui a entraîné un appauvrissement certain du savoir médical traditionnel. L’enquête que nous menons depuis plusieurs années dans différentes régions du Maroc montre à l’évidence que les praticiens d’aujourd’hui sont beaucoup moins instruits sur les choses de la médecine que ne l’étaient leurs prédécesseurs. De la même manière, l’art galénique (NDLR : médecine par les plantes) n’est plus que l’ombre de ce qu’il fut autrefois et se trouve réduit à quelques recettes de grimoires. L’ingérence de l’irrationnel en médecine et la croyance en des causalités supranaturelles en matière de diagnostic, viennent encore assombrir le tableau. Sans parler de l’intrusion de substances industrielles modernes dans la pharmacopée populaire et de la rapide mercantilisation de la profession qui ouvre très grandes les portes aux dangers du charlatanisme.
D’autre part, la plus grande diffusion des textes classiques de la médecine arabo-islamique, rendue possible grâce au développement de maisons d’édition arabes, n’a pas pourvu complètement à la disparition des lieux traditionnels d’enseignement et a facilité la généralisation des traités les moins bons - mais dont l’abord est plus simple - du type du Kitâb er-rahma d’Al-Soyoti et des innombrables Tibb en-nabawî. Ainsi globalement, nous pouvons dire que la médecine traditionnelle au Maroc a, petit à petit, perdu l’essentiel de sa substance théorique et de son cadre doctrinaire.
Q : Quel a été votre travail de terrain pour retrouver le savoir-faire de l’oralité en voie d’extinction, dédaigné, ignoré, victime d’amnésie et y a-t-il des régions au Maghreb qui sont plus riches en plantes médicinales que d’autres ?
R : J’ai commencé ma carrière professionnelle de chercheur en 1969 (j’étais alors jeune diplômé à 22 ans) par une grande enquête ethnobotanique dans les provinces sahariennes du pays. Cette enquête qui fut publiée en 1978 (Bellakhdar J., Médecine traditionnelle et toxicologie ouest-sahariennes, 286 p., Editions techniques nord-africaines), reçut immédiatement l’adhésion de la presse, des lecteurs et de la communauté scientifique car pour la première fois un chercheur s’intéressait à ce domaine de la pratique et du savoir des hommes qui semblait, à cette époque, tenir une place incertaine entre la science du réel et l’ordre du mystère. Les Marocains furent aussi probablement flattés que leur médecine traditionnelle, trop longtemps décriée, puisse faire l’objet d’une étude scientifique qui était perçue, d’une certaine façon, comme une réhabilitation.
Très vite je me suis plu dans ce rôle de chercheur aux pieds nus, travaillant au confluent de la botanique, de la pharmacologie et de l’anthropologie, et j’étendis petit à petit mes recherches de terrain à d’autres régions du Maroc. Depuis 1978, j’ai parcouru ainsi à travers tout le pays plusieurs milliers de kilomètres, en voiture, en 4x4, à dos de mulet ou à pied. Ces déplacements me conduisirent dans toutes les régions, y compris dans les régions les plus reculées, à la rencontre des tradipraticiens, des herboristes, des récolteurs de plantes et, d’une manière générale, de toutes les personnes susceptibles de me fournir des informations sur la pharmacopée et le système de soins en usage au Maroc.
La tâche ne fut pas toujours facile : j’ai dû souvent emprunter des pistes impraticables dans les sables ou dans la rocaille ; traverser des gués dangereux avec des voitures qui n’étaient pas équipées pour ce genre d’exploits ; escalader de rudes montagnes ; chevaucher des montures inconfortables ; suivre des nomades sur les chemins de leur transhumance ; ou pénétrer dans des bidonvilles qui étaient de véritables labyrinthes. Mais, dans ce genre d’expéditions, on peut aussi connaître quelques moments de rare bonheur : se retrouver seul au milieu d’une nature sauvage et grandiose ; tomber, tout d’un coup, au détour d’un chemin, sur un paysage d’une grande beauté ; ou rencontrer des hommes très différents de soi, des hommes simples et un peu rustres, mais possédant une grande expérience du milieu et la sagesse des Anciens.
Ces hommes-là qui furent mes informateurs et qui se sont ouverts à moi de leur savoir, furent aussi mes hôtes : j’ai en effet souvent partagé leur toit et leurs repas, qui m’étaient offerts dans les pures traditions d’hospitalité du monde rural.
Partager ? Seul celui qui n’a rien (ou si peu) et qui vous donne tout, sait ce que cela coûte et ce que cela signifie : dans bien des cas, des efforts importants de privation pendant les jours qui suivent le passage de l’étranger. Aussi, ai-je gardé une grande admiration pour les qualités de cœur de ces gens et pour leur sens du contact humain. Autant que leur connaissance de la tradition, ils m’ont apporté la révélation qu’il existait aussi dans la vie, des plaisirs non matériels et des richesses intérieures inestimables.
Au contact de ces hommes, j’ai peu à peu pénétré le monde passionnant de la tradition et accumulé une quantité appréciable de renseignements sur les croyances, les mentalités, les conceptions de la vie et de la mort, de la santé et de la maladie, le système de soins et la pharmacopée.
Mes enquêtes sur le terrain ont été quelquefois prolongées par des recherches au laboratoire. J’ai ainsi sélectionné certaines plantes aromatiques utilisées localement en thérapeutique, plantes intéressantes à étudier du point de vue de leur composition chimique, en raison de leur caractère endémique, de leur position taxinomique ou de leur importance économique locale. Les analyses, réalisées en collaboration avec d’autres chercheurs, ont porté sur les huiles essentielles de ces plantes et sur leurs composants aromatiques. Les résultats auxquels nous sommes parvenus ensemble ont fait l’objet de publications dans diverses revues nationales ou internationales.
Ces recherches m’ont démontré qu’il existait dans toutes les provinces du Maroc, une connaissance appréciable des plantes, de leurs propriétés, supposées ou réelles, et de leurs usages. On trouve partout des usages intéressants à évaluer scientifiquement, les cas les plus pertinents étant probablement ceux qui se rapportent aux espèces endémiques, c.à.d. aux espèces qui sont spécifiques à des milieux locaux particuliers et qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Personnellement, c’est dans les environnements les plus extrêmes (déserts, régions arides et massifs montagneux) que j’ai recueilli les données les plus originales.
Q : On se pose toujours la question de savoir pourquoi certaines plantes sont des vedettes du fait qu’elles sont sollicitées plus que d’autres pour leurs effets bénéfiques et donc surexploitée ?
R : Chaque plante a son histoire. Chaque population a aussi ses représentations culturelles de la maladie et du remède. Certaines plantes sont devenues des médicaments-phares pour une affection donnée, d’autres de véritables panacées préconisées contre plusieurs maladies à la fois, d’autres encore ont sombré dans l’oubli de nos contemporains alors qu’elles avaient autrefois un grand prestige qui les faisait importer de très loin.
Il n’y a, bien entendu, pas un modèle unique pour expliquer la notoriété particulière d’une espèce végétale ou d’un remède naturel. Certaines fois, c’est une activité pharmacologique réelle qui détermine l’attachement des gens à son usage. D’autres fois, c’est une efficacité supposée, une attribution symbolique, rapportée à une croyance, à une légende, à une recommandation d’un savant arabe, à un épisode de l’histoire du prophète Mohammed, qui va déterminer le destin d’un simple. Dans le premier cas, celui des plantes dont les propriétés sont démontrables, nous avons, par exemple, l’armoise blanche, l’origan, la menthe pouliot, le carvi, le cumin velu, le fenouil, le fenugrec, le néflier du Japon, le plantain, le séné, pour n’en citer que quelques unes. Dans le second cas, celui des plantes référentielles, nous pouvons classer le calcul biliaire de bœuf ou de gazelle (bid al-mohor), la huppe, les tubercules d’orchidées (l-hayya wa l-mayta), la nigelle, l’eau miraculeuse de bir zem-zem, etc.
Certains remèdes ont aussi acquis un grand prestige en raison de leur rareté : le tabachir (concrétion du bambou importée d’Asie), le muqul-mekki (résine de l’Hyphaene des déserts d’Arabie) et l’ase fétide (résine d’une ombellifère d’Asie centrale) qui étaient réputés antidotes de tous les poisons et venins, alors même qu’ils ne protègent même pas des piqûres de moustiques ; d’autres plantes étaient sensées préserver des grandes épidémies ou même de la foudre. Ces croyances nous paraissent aujourd’hui totalement naïves, mais elles ont servi autrefois à construire des réputations qui se maintiennent encore aujourd’hui, alors même que les situations qui les ont vu naître ont totalement disparu. Il est vrai que les mythes sont souvent difficiles à abattre.
La plupart des comportements issus de ces croyances sont totalement inoffensifs et sans conséquences. Mais il peut arriver qu’ils soient la cause de graves préjudices portés à l’homme ou à la nature : perte de temps avant de recourir à de véritables soins, dans certains cas ; surexploitation des ressources de la nature et dévastation des espèces rares dans d’autres cas (cornes de rhinocéros et verge de tigre en Asie, résine du sang-dragon de Socotora au Moyen-Orient, feuilles de Warionae saharae au Maroc, etc.). Il est donc important dans ces situations un peu spéciales de conscientiser les gens et même d’interdire purement et simplement certains usages.
Q : Est-ce qu’il y a des plantes spécifiquement maghrébines car on a l’impression en lisant votre livre que les plantes migrent comme les hommes et qu’elles sont de provenances diverses Inde, Amérique ?
R : Oui, il y a des plantes spécifiquement maghrébines, ou même marocaines, et d’autres dont l’aire de répartition naturelle est encore plus restreinte en raison de facteurs particuliers géographiques, paléogéographiques, paléoclimatiques ou génétiques. Ainsi, on peut trouver des espèces cantonnées strictement dans certaines régions (une montagne, une zone désertique, une bande de littoral) à propos desquelles moins on communiquera, mieux elles seront protégées. Au total, le Maroc, pour prendre l’exemple de notre pays, abrite 800 espèces et sous-espèces relevant de cette catégorie de plantes qu’on appelle endémiques, soit 19% de la flore marocaine. Bien entendu, sur ces 800 espèces, seules quelques unes reçoivent actuellement un usage médicinal, ce qui n’est pas plus mal, car le succès d’une plante entraîne automatiquement une exploitation intempestive de celle-ci. Par contre l’étude de ces plantes propres à un territoire, du point de vue de leurs usages traditionnels, de leurs propriétés et de leurs compositions s’avère très intéressante, car ces recherches peuvent aboutir à la découverte de nouvelles molécules pharmacologiquement actives et procurer des modèles inédits de structures pour la mise au point de nouveaux médicaments.
Ce sont ces plantes spécifiques qui donnent à la pharmacopée d’un pays une empreinte de territorialité plus ou moins forte selon le taux d’endémicité de la flore locale. Ce caractère de territorialité contrebalance l’autre caractère de ces pharmacopées : leur cosmopolitisme. En effet, les plantes voyagent aujourd’hui avec les hommes, grâce au commerce international et au développement de l’agriculture. Elles nous arrivent sous forme de marchandises (cannelle, clou de girofle, muscade, poivre, fibres de raphia, noix de coco, pour ne prendre que quelques exemples), mais aussi sous forme de plants et de semences qui permettent leur acclimatation et leur multiplication dans différentes régions du monde. C’est d’ailleurs comme cela que nous sont arrivés la tomate, le poivron, le maïs, la pomme de terre, la verveine odorante, etc.
Les pharmacopées nationales puisent leurs remèdes dans l’ensemble de ces ressources : c’est cela qui fait qu’on peut trouver dans l’arsenal des plantes médicinales utilisées au Maghreb des espèces qui n’y poussent pas spontanément.
Q : Comme on parle d’animaux en voie d’extinction on parle aussi de plante en voie de disparition à cause de la surexploitation et aussi peut-être à cause d’un processus de sélection naturelle avec des plantes parasites qui se développent plus rapidement que les autres et grignotent l’espace vital ?
R : Je suppose que vous voulez parler des plantes adventices qui ne sont pas véritablement des plantes parasites (au sens botanique du mot) mais des espèces qui se développent dans les cultures comme mauvaises herbes. Certaines d’entre elles, très compétitives, peuvent constituer une gêne pour celles-ci, mais en aucun cas elles ne présentent un danger pour la flore naturelle. Ajoutons qu’une mauvaise herbe du point de vue de l’agriculteur peut être considérée comme une bonne herbe du point de vue du pharmacien ou de l’industriel.
En réalité la vraie menace pour ces plantes vient de l’homme qui n’exploite pas toujours les ressources de la nature de manière raisonnée et raisonnable.
Q : Que dire du secteur des herboristes et des guérisseurs qui est florissant sachant que, du fait que la plante médicinale est entrée dans le commerce, il y a des dérives et souvent la question du charlatanisme est soulevée ? Quels rapports entre pharmaciens et herboristes, rapports de complémentarité ou de conflits ?
R : On ne peut pas dire qu’il y ait vraiment concurrence entre les deux secteurs, traditionnel et moderne, de la santé. Quand on veut acheter du khôl, du savon noir, du ras el-hanût, du benjoin (jawi) ou de l’armoise blanche (chih), on se rend naturellement chez l’herboriste ; et au sortir d’une consultation au dispensaire ou au cabinet médical, c’est évidemment chez le pharmacien qu’on va se faire servir son ordonnance. C’est tout au plus, dans le domaine de l’automédication, quand elle concerne des petits bobos, que les champs d’action peuvent se chevaucher, encore que, bien souvent, à dépense égale, c’est le pharmacien qui a le dernier mot.
Dans l’état actuel des choses, les uns et les autres s’ignorent royalement, bien qu’épisodiquement quelques professionnels du secteur moderne de santé s’élèvent, souvent à tort mais parfois aussi à raison, contre les dangers que représente la pratique de la médecine traditionnelle et que, de l’autre côté, quelques associations d’herboristes s’indignent, un peu n’importe comment, il faut bien le dire, de ce que leur métier ne bénéficie toujours pas d’un statut officiel.
Dans notre pays, le pharmacien, en raison de la formation qu’il reçoit, de l’encadrement administratif de sa profession, des engagements déontologiques qu’il prend et de la responsabilité juridique qui pèse sur lui, est le seul habilité légalement à délivrer tout produit considéré comme un médicament, y compris les plantes médicinales actives. Le métier d’herboriste traditionnel, quant à lui, ne bénéficie que d’un statut de tolérance justifié par l’antériorité historique de son existence au sein de la société marocaine ainsi que par la fonction éminemment sociale qu’il a joué autrefois et qu’il continue à jouer, notamment auprès des couches les plus défavorisées de la population.
Peut-on changer ce statut quo, dans un sens ou dans un autre ? La question fait aujourd’hui débat, car, d’une part, le nombre de pharmaciens diplômés arrivant sur le marché a tendance à exploser ces dernières années, d’autre part, le métier d’herboriste traditionnel devient de plus en plus une alternative au chômage pour de nombreux jeunes arrivant sur le marché du travail, sans qualification particulière. Dans ce dernier secteur, nous sommes donc loin aujourd’hui de la traditionnelle chaîne de transmission initiatique du savoir des plantes, transmission de maître à élève ou de père à enfant, car toutes les enquêtes montrent que la majorité des nouveaux tradipraticiens qui s’installent ne sont ni les fils ni les anciens apprentis d’herboristes, mais bien des professionnels autoproclamés. Les conditions traditionnelles d’exercice de la profession, qui servaient plus ou moins de garde-fous contre les abus et les usurpations de compétence, sont donc en voie d’extinction.
On voit par conséquent mal aujourd’hui comment on pourrait donner un statut légal à une profession complètement informelle et que tout le monde pourrait exercer, sans qualification particulière, sans obligations et devoirs précis, sans engagement de responsabilité et sans encadrement administratif rigoureux.
Précisons, au surplus, que toute mesure hâtive et irréfléchie de légalisation de cette profession, adoptée de manière démagogique et sans concertation comme palliatif au chômage, n’empêchera pas la prolifération, aux marges de la nouvelle profession, d’herboristes non reconnus et de charlatans. Il faudrait alors sévir, ce qui conduirait à remplacer une politique de tolérance par une politique de répression, ou à déplacer l’état de tolérance d’un premier rang vers un deuxième rang. Il est fort à parier, que dans cette occurrence, c’est la deuxième attitude qui prévaudrait. Au final, on se serait seulement donné l’illusion d’avoir réglé le problème.
Une étude sérieuse de ce qui s’est fait dans d’autres nations qui ont accordé une place officielle dans le système de santé à leur médecine traditionnelle (Inde, Pakistan, Chine, Vietnam, etc.), montre que ces nations ont d’abord commencé à évaluer scientifiquement leurs traditions médicales, à constituer des pharmacopées, des listes de simples autorisés à être mis sur le marché et des formulaires nationaux, puis à partir de là seulement, à organiser des enseignements officiels de médecine traditionnelle débouchant sur la délivrance de titres fondant un droit légal d’exercice. Parallèlement à cela, l’enseignement de l’art médical traditionnel a été développé dans les Universités nationales pour que les médecins et pharmaciens du secteur moderne de santé soient, eux-mêmes, dans la capacité d’exercer pleinement leur métier, en étant à l’aise aussi bien dans le registre des remèdes modernes qu’avec l’arsenal thérapeutique traditionnel. Cette voie est indiscutablement la voie à suivre.
Je me prononce personnellement, au stade où nous en sommes, pour le maintien du statut quo actuel, l’urgence étant surtout, et d’abord, d’élaborer un formulaire national des plantes médicinales et de codifier leur emploi, ce qui va demander déjà beaucoup de travail et pas mal de temps. Je suis moi-même convaincu, que dans les années à venir, de jeunes pharmaciens diplômés, didactiquement mieux préparés à la connaissance des plantes de la tradition et contraints par la pression du marché à chercher des solutions originales, investiront petit à petit le secteur de la vente des plantes médicinales et le moderniseront du même coup du fait de la compétence technique qu’ils auront acquis au cours de leurs études : c’est déjà le cas dans des pays de tradition médicale arabo-islamique comme l’Egypte, la Syrie, la Malaisie ou l’Indonésie où les herboristeries des villes sont tenues bien souvent par des pharmaciens.
Q : On peut remarquer qu’il y a pas mal de plantes qui ont à peu près les mêmes constituants et donc les mêmes effets sur l’organisme et cela semble donner une impression de répétition ?
R : C’est exact, bien que les autres molécules associées aux constituants principaux soient très souvent différentes, ce qui permet de moduler les actions, de jouer avec une palette d’indications plus large et de proposer des prescriptions plus personnalisées. D’autre part, c’est important d’avoir ainsi sous la main une plus grande diversité de plantes quand l’objectif est de faire au mieux avec les moyens disponibles. Abondance et liberté de choix valent mieux que pénurie et dépendance.
Q : Dans votre monographie vous dites avoir procédé à une sélection pour ne retenir que 144 espèces de plantes médicinales. Comment avez-vous procédé ?
Combien d’autres plantes ont été repoussées de votre monographie ?
R : Il est exact que dans mon ouvrage je n’ai traité, selon le modèle de la fiche monographique, que 144 espèces végétales. Mais j’ai, dans une deuxième partie du texte, décrit de manière plus concise 34 plantes supplémentaires.
J’ai sélectionné l’ensemble de ces plantes selon des critères rigoureux d’efficacité, de disponibilité locale (dans la flore locale ou dans le commerce) et d’innocuité pour les utilisateurs, sachant que mon ouvrage est destiné à servir de guide d’utilisation accessible au plus grand nombre, souvent d’ailleurs en automédication familiale. Pour ce faire, j’ai tenu compte des avancées les plus récentes dans le domaine de la pharmacologie moderne et consulté un très grand nombre de standards internationaux en matière de santé publique. Ce travail approfondi de rationalisation des usages m’a obligé à écarter des dizaines de plantes pouvant être actives mais présentant de vrais dangers ou développant des effets secondaires pouvant constituer une gêne si importante que le bénéfice de la plante finit par passer au second plan ou être tout simplement annulé. Au nombre des plantes que j’ai écartées, plusieurs d’ailleurs sont utilisées, avec tous les risques que cela comporte, par notre médecine traditionnelle.
Entretien réalisé par Saïd Afoulous
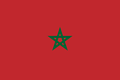 Santé Maghreb au Maroc
Santé Maghreb au Maroc![]() APIDPM © Copyright 2000-2026 - Tous droits réservés. Site réalisé et développé par APIDPM Santé tropicale.
APIDPM © Copyright 2000-2026 - Tous droits réservés. Site réalisé et développé par APIDPM Santé tropicale.