
Accès à la rubrique « Autogestion de la santé »
Consultez les mentions légales (RCP) des médicaments disponibles dans votre pays
![]() Médecine d'Afrique Noire
Médecine d'Afrique Noire
Consulter la revue
![]() Médecine du Maghreb
Médecine du Maghreb
Consulter la revue
![]() Odonto-Stomatologie Tropicale
Odonto-Stomatologie Tropicale
Consulter la revue
Restez informés : recevez, chaque jeudi, la lettre d'informations de Santé Maghreb.
Accueil > Santé Maghreb au Maroc > Revue de presse
Le matin | Maroc | 19/07/2007
Ce programme de recherche aura un impact indéniable en terme de santé»,
explique Mme El Kadiri Leila, membre
du département coopération du CNRST.
En effet, l'objectif principal de ce projet est de contribuer à mieux
comprendre les mécanismes physiopathologiques du retard mental et des
syndromes poly malformatifs, par une approche génétique et moléculaire
mettant en commun les moyens des équipes marocaines et françaises.
Un réseau de neuropédiatres, de pédopsychiatres, de biochimistes, de neuroradiologues, de généticiens et de biologistes moléculaires sera mis en place dans le but de progresser rapidement dans la compréhension des mécanismes, très hétérogènes, à l'origine de ces pathologies.
Par ailleurs, et en raison du taux de consanguinité élevé dans la population marocaine, un effort particulier sera fourni pour l'identification et l'étude de la fonction de nouveaux gènes impliqués dans des formes récessives du retard mental et des syndromes poly-malformatifs rares.
La mise en place de ce programme de recherche va permettre une plus grande intégration de l'équipe marocaine dans les travaux de recherche de haut niveau et le renforcement de ses capacités diagnostiques, avec des conséquences immédiates sur les patients et leurs familles.
Cependant, ce projet sera basé sur une complémentarité entre les équipes marocaine et française, de la recherche clinique et de terrain à l'usage des plateformes de hautes technologies de l'après gène.
Les résultats attendus sont donc: la découverte de nouveaux gènes impliqués, en particulier dans les formes autosomiques récessives de ces pathologies, la réalisation de nouvelles études fonctionnelles en cas de découverte de nouvelles protéines, la détermination de l'importance des microremaniements chromosomiques chez les patients porteurs d'un retard mental associé ou non à une dysmorphie et dont l'étiologie est indéterminée, la prévalence chez les patients marocains de certaines formes de retards mentaux à gènes connus, une réflexion sur l'information, le conseil génétique, les moyens de prévention et le suivi médical des patients et de leurs familles, la formation par la recherche des médecins et jeunes doctorants marocains.
Reste à signaler que le CNRST avait déjà signé
en 1999 une convention de coopération avec l'INSERM.
Par le biais de cette convention, une cinquantaine de projets a été
financée et plus d'une dizaine de bourses postdoctorales ont été
attribuées à des étudiants marocains, afin de mener leur
recherche médicale en France.
Cette fructueuse coopération a aussi été concrétisée par la création d'un Laboratoire international associé (LIA).
Un laboratoire, rappelons le, qui unit le département de génétique de l'Institut national d'hygiène et l'équipe INSERM «Génétique et embryologie des malformations congénitales» de l'Hôpital Necker en France.
L'institut en question
Créé en 1964, l'INSERM est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche.
C'est le seul organisme public de recherche français entièrement dédié à la santé humaine. Ses chercheurs ont pour vocation l'étude de toutes les maladies des plus fréquentes aux plus rares, à travers leurs travaux de recherches biologiques, médicales et sur la santé des populations.
Pour remplir cette mission, l'Institut a été conçu dès l'origine dans un partenariat étroit avec les autres établissements de recherche publics ou privés, et les lieux de soins que sont les hôpitaux. Aujourd'hui, 85% des 339 laboratoires de recherche Inserm sont implantés au sein des centres hospitalo-universitaires, ou des centres de lutte contre le cancer, les autres étant situés sur les campus de recherche du CNRS ou encore des instituts Pasteur ou Curie.
13.000 personnes (dont 6.000 chercheurs) travaillent dans les 335 unités de recherche de l'Inserm, réparties sur l'ensemble du territoire français.
Rajaa Kantaoui
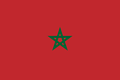 Santé Maghreb au Maroc
Santé Maghreb au Maroc![]() APIDPM © Copyright 2000-2025 - Tous droits réservés. Site réalisé et développé par APIDPM Santé tropicale.
APIDPM © Copyright 2000-2025 - Tous droits réservés. Site réalisé et développé par APIDPM Santé tropicale.