
Accès à la rubrique « Autogestion de la santé »
Consultez les mentions légales (RCP) des médicaments disponibles dans votre pays
![]() Médecine d'Afrique Noire
Médecine d'Afrique Noire
Consulter la revue
![]() Médecine du Maghreb
Médecine du Maghreb
Consulter la revue
![]() Odonto-Stomatologie Tropicale
Odonto-Stomatologie Tropicale
Consulter la revue
Restez informés : recevez, chaque jeudi, la lettre d'informations de Santé Maghreb.
Accueil > Santé Maghreb au Maroc > Revue de presse
L'économiste | Maroc | 23/09/2016
Les tarifs des autopsies sont fixés par la loi réglementant les frais de justice en matière pénale publiée au Bulletin officiel du 18 février 1987 (version française). Un praticien, « régulièrement requis ou commis » d’office par la justice, reçoit ses honoraires qui englobent l’examen de la dépouille, la rédaction et le dépôt du rapport au tribunal (Ph. L’Economiste)
N’importe qui peut s’improviser médecin légiste. Caricatural certes, mais c’est l’inquiétant constat relevé par le rapporteur spécial de l’ONU sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants lors de sa mission en septembre 2012 au Maroc (voir page 25). Malgré une grosse pénurie d’expertise, les médecins-légistes ne sont pas habilités à s’inscrire dans les tableaux d’experts judiciaires des cours d’appel ou au niveau national. Les non spécialistes en médecine légale, eux, doivent seulement justifier d’une ancienneté d’exercice. « Pas besoin de formation spécifique. Y compris pour l’évaluation du dommage corporel (en cas d’accident de la route, du travail...) », relève à son tour le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).
Sous peine de poursuite disciplinaire, le ministère de la Santé refuse aux médecins légistes le droit d’être experts judiciaires. Motif ? « C’est une activité libérale dont l’exercice est incompatible avec le statut de la fonction publique », note le CNDH dans une étude de 2013 sur la médecine légale. Un ex-chef de division au ministère concerné cite l’article 15 du Statut de la fonction publique qui « interdit l’exercice à titre professionnel d’une activité lucrative privée ou relevant du secteur privé ». Notre source évoque « une règle d’incompatibilité applicable à tous les fonctionnaires ». Le Dahir de 1958 prévoyait, selon l’ancien haut responsable ministériel, qu’« un fonctionnaire pouvait exercer dans le privé sous certaines conditions et sous réserve d’obtenir l’accord préalable du Premier ministre ». Cette exception « a été supprimée ».
En réalité, le Statut de la fonction publique permet encore l’exercice de certaines activités en libéral : enseignement, consultation et expertise... Mais à condition que « ces activités soient exercées à titre occasionnel, pour une durée limitée et que le caractère commercial n’y soit pas dominant ».
Le Pr Hicham Benyaich, médecin chef de l’Institut médico-légal au CHU de Casablanca, a lui-même « fait les frais de l’interdiction basée sur cette lecture particulière de la loi ». Un légiste n’a pas droit d’être expert judiciaire. Le praticien assure avoir reçu il y a quelques années un courrier officiel dans ce sens. Du temps où Khadija Mishak était directrice des affaires juridiques au ministère de la Santé. « Or la loi régissant l’expertise judiciaire consacre des modalités particulières aux fonctionnaires », déclare le Pr Benyaich également président de la Société marocaine de médecine légale. Etre fonctionnaire n’est pas disqualifiant si l’on se limite aux conditions d’inscription prévues par la loi n°45-00 sur les experts judiciaires.
L’avis du ministère de la Santé est discutable. Au nom de l’intérêt public, il devrait adopter une position pragmatique. Le manque d’expertise cumulé à ses conséquences sur les droits de la défense et de la victime pèsent lourd sur le bon déroulement de la justice. Même si l’expertise ne lie pas le juge dans sa décision finale.
Le rapporteur de l’ONU a d’ailleurs sèchement critiqué « la mauvaise qualité des expertises notamment dans les cas d’allégation de torture ou de mauvais traitements ».
En pratique, une juridiction a toujours une marge de manœuvre : « Le juge peut désigner exceptionnellement un expert non inscrits au tableau(1). Mais à condition que ce dernier prête serment. Sans quoi, son intervention peut être attaquée par l’une des parties au procès pour vice de forme », déclare le porte-parole de la Société marocaine de médecine légale.
Quoiqu’étroite, cette brèche permet à des médecins légistes (fonctionnaires) d’agir en cas de besoin. Mais c’est la croix et la bannière en cas d’intervention dans des procédures judiciaires. Il y a d’abord les modiques honoraires payés en guise de frais de justice (voir illustration). Et qui ne couvrent même pas les 3 exemplaires du rapport d’expertise déposés au tribunal. Le paiement se fait par chèque libellé au nom de la Trésorerie générale du Royaume. En supposant qu’un praticien de la capitale économique intervient à Kénitra sur demande du parquet. « Ses honoraires lui seront remis à Casablanca et devra se déplacer à Rabat pour se faire payer », témoigne le Pr Benyaich (voir encadré). « Rationaliser et simplifier les procédures de paiement » figure parmi les recommandations du 5e colloque régional du Dialogue national sur la réforme de la justice tenu les 9 et 10 novembre 2012 à Fès. Le CNDH revient à la charge un an plus tard en rappelant « les enjeux importants des activités médico-légales pour une bonne administration de la justice, tant civile que pénale... ». Un bon coup de bistouri garantit aussi l’accès à un procès équitable. Alors que la réforme de la médecine légale « vise aussi à donner plus de crédibilité aux certificats et expertises médicales », ambitionnait le ministère de la Justice.
Des frais de justice qui n’ont pas bougé depuis 30 ans !
Les 5 recommandations d’un praticien
(1) Article 55 du code de procédure civile
Faiçal FAQUIHI
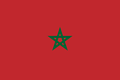 Santé Maghreb au Maroc
Santé Maghreb au Maroc![]() APIDPM © Copyright 2000-2026 - Tous droits réservés. Site réalisé et développé par APIDPM Santé tropicale.
APIDPM © Copyright 2000-2026 - Tous droits réservés. Site réalisé et développé par APIDPM Santé tropicale.