
Accès à la rubrique « Autogestion de la santé »
Consultez les mentions légales (RCP) des médicaments disponibles dans votre pays
![]() Médecine d'Afrique Noire
Médecine d'Afrique Noire
Consulter la revue
![]() Médecine du Maghreb
Médecine du Maghreb
Consulter la revue
![]() Odonto-Stomatologie Tropicale
Odonto-Stomatologie Tropicale
Consulter la revue
Restez informés : recevez, chaque jeudi, la lettre d'informations de Santé Maghreb.
Accueil > Santé Maghreb au Maroc > Revue de presse
L'économiste | Maroc | 15/06/2016
Un segment qui devrait impacter l’export. La mutualisation faciliterait l’installation d’unités de production. En quête de nouveaux marchés à l’export, l’industrie pharmaceutique multiplie ses chances pour optimiser l’offensive à l’international. Parmi les choix offerts à la corporation, figure le segment des biotechnologies, notamment le bio-développement : « De la molécule à la production et la commercialisation ». En clair, le développement de nouvelles molécules et de médicaments bio-similaires. « Ce segment représente un intrant stratégique.
Cette discipline permet de développer des vaccins. Une responsabilité que nous avons héritée du public », précise Aymen Cheikh Lahlou, président de l’Association de l’industrie pharmaceutique (Amip). Et d’ajouter : « Tous les opérateurs maghrébins sont actifs en Afrique subsaharienne, cette offre bio-similaire viendra renforcer le portefeuille de produits marocains, voire maghrébins, dans la région ».
Selon le spécialiste en biotechnologie Merck, les bio-produits représentent 20% des ventes de l’industrie pharmaceutique à travers le monde. Au niveau de l’Afrique, ce marché représente un chiffre d’affaires de 20 milliards de dollars, dont seulement 10% reviennent au bio-développement. « L’industrie pharmaceutique est face à 3 challenges, notamment investir rapidement, diminuer le risque financier ou encore assurer un prix de revient qui permet la vente sur le marché local », explique le management de Merck. Pour résoudre cette équation, la corporation compte sur la mutualisation des investissements et, par ricochet, la réduction des coûts. Une solution qui s’avère judicieuse sachant qu’une unité de bio-similaire et de vaccins nécessite un investissement de 100 millions d’euros. « Nous ne sommes pas des multinationales habituées à gérer des activités dans plusieurs pays. Chose que nous devons apprendre. L’étape clinique reste assez coûteuse malgré une baisse substantielle des prix et l’absence de la composante R&D.
C’est pour cela qu’il faut mutualiser », rappelle le président de l’Amip. C’est d’ailleurs à ce niveau que compte intervenir le géant allemand Merck. L’entreprise propose aux opérateurs pharmaceutiques d’acquérir un modèle de production ajustable en fonction des besoins spécifiques de la molécule à développer. En clair, la multinationale propose une usine flexible dont la zone de production est configurable rapidement afin de fluidifier les process. Une offre qui repose sur le volet pré-assemblé et pré-stérilisé, ce qui permettrait de diminuer les risques de contamination ou encore les coûts d’utilisation grâce à la simplicité du process et le besoin limité en main-d’œuvre. S’y ajoute un délai de production de 48 mois pour que le produit soit disponible. « Nous avons fait travailler les équipes pendant 4 ans pour adapter la solution aux marchés émergents. Ce n’est pas par charité, mais pour gagner des marchés en ouvrant cette technologie vers les pays émergents malgré les risques sur la propriété industrielle et la fragmentation des marchés », soutient Karim Bendhaou, président de Merck pour NW Africa.
Synergie intra-pays
Mettre en place des unités de bio-similaire nécessite de dépasser la barrière de l’investissement qui est de 100 millions d’euros. La faible demande du marché intérieur et les barrières réglementaires sont autant de freins à l’éclosion de ce marché. « Même avec les fonds, le problème est dans l’accès au marché. La seule solution est que les opérateurs de la région arrêtent de produire les mêmes médicaments. Les pays doivent se répartir les spécialités », recommande Aymen Cheikh Lahlou, président de l’Amip. Pour cet opérateur, la synergie intra-pays permettrait de ramener cette technologie à l’échelle de l’Afrique du Nord et avec des investissements à la taille de l’Afrique du Nord.
Amine ATER
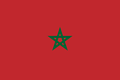 Santé Maghreb au Maroc
Santé Maghreb au Maroc![]() APIDPM © Copyright 2000-2026 - Tous droits réservés. Site réalisé et développé par APIDPM Santé tropicale.
APIDPM © Copyright 2000-2026 - Tous droits réservés. Site réalisé et développé par APIDPM Santé tropicale.