
Accès à la rubrique « Autogestion de la santé »
Consultez les mentions légales (RCP) des médicaments disponibles dans votre pays
![]() Médecine d'Afrique Noire
Médecine d'Afrique Noire
Consulter la revue
![]() Médecine du Maghreb
Médecine du Maghreb
Consulter la revue
![]() Odonto-Stomatologie Tropicale
Odonto-Stomatologie Tropicale
Consulter la revue
Restez informés : recevez, chaque jeudi, la lettre d'informations de Santé Maghreb.
Accueil > Santé Maghreb au Maroc > Revue de presse
L'économiste | Maroc | 08/12/2014
Claude Le Pen est l’un des meilleurs spécialistes mondiaux de l’économie de la santé. HEC, docteur en épistémologie économique et en sciences économiques, il est professeur agrégé à Paris Dauphine où il dirige le master d’économie de la santé. Claude Le Pen est intervenu à la 18e Journée des pharmaciens fabricants répartiteurs à Casablanca.
- L’Economiste : Au Maroc, au-delà du prix du médicament, il faut gérer le dilemme de l'accès aux soins. Comment concilier ces deux impératifs ?
- Claude Le Pen : C’est le grand paradoxe des dépenses de santé en général et des dépenses pharmaceutiques en particulier: d’un côté, elles sont une conséquence du développement économique et social auquel elles contribuent fortement, mais, d’un autre côté, elles sont financées par des fonds publics qui ne peuvent augmenter indéfiniment. Pour faire face à la demande croissante de santé sans trop augmenter les dépenses publiques, les gouvernements ont tendance à jouer sur les prix qui sont faciles à contrôler. Mais une pression excessive sur les prix peut décourager la production locale, qu’il s’agisse des firmes nationales ou internationales, et menacer l’emploi. C’est une équation difficile à laquelle il n’existe pas de solution miracle. Je crois quand même qu’il existe des politiques meilleures que d’autres, notamment celles qui sont prévisibles, claires, contractuelles et qui regardent vers le moyen-long terme.
Une des leçons de la grande crise mondiale que nous n’avons encore pas fini de traverser, c’est que les pays qui s’en sortent le mieux sont ceux qui ont su préserver une forte base industrielle et un bon équilibre entre des activités industrielles et des activités plus séduisantes mais plus volatiles comme la finance ou le tourisme.
- Où voyez-vous, à moyen terme, les gisements de croissance de l'industrie pharmaceutique marocaine ?
- Le Maroc est incontestablement sur la liste des pays candidats à devenir des « pharmerging ». Cela tient à sa population de près de 35 millions d’habitants, à sa croissance économique, au développement des classes moyennes qui aspirent à une meilleure qualité de vie et à des programmes sociaux du type Ramed visant à « solvabiliser » la demande des plus démunis. J’ajoute une certaine tradition pharmaceutique, puisqu’il existe une industrie locale relativement ancienne et des professionnels de santé bien formés. Ce sont les ingrédients que l’on retrouve dans la plupart des pays ayant percé au plan mondial.
- Que change, pour les « big pharma », l’extension des pathologies dites de pays « riches » aux pays en développement ?
Traditionnellement, les médicaments les plus vendus dans les pays en développement
Les « big pharma » redessinent la géopolitique du médicament.
Les « pays frontières » regroupent des marchés qui connaîtront une croissance des ventes de médicaments se situant entre 250 millions et 1 milliard de dollars dans les 5 prochaines années
étaient les antibiotiques, les antiparasitaires et les vaccins. Mais on voit depuis plusieurs années le marché s’orienter vers les pathologies chroniques comme l’hypertension artérielle, le diabète – très prévalent au Moyen-Orient – l’hypercholestérolémie, ainsi que les pathologies dermatologiques ou gastro-intestinales. Cela étant, ces pathologies sont excellemment traités par des médicaments génériques à faible coût, souvent produits par des firmes locales.
La plupart des grandes innovations ces dernières années visent le cancer ou les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde et restent assez largement des médicaments de pays « riches ». Ce sont des produits de prix élevés, souvent issus des biotechnologies, destinés à des populations assez restreintes, intervenant souvent en deuxième ou troisième intention après échec d’une première ligne de traitement et restant d’administration délicate avec, par exemple, la nécessité d’un respect rigoureux de la chaîne du froid. Le modèle de croissance des marchés émergents est celui d’un marché de masse à bas coût alors que la R&D de la « big pharma » est plutôt orientée vers des marchés de niche à coûts élevés.
- Vers quelles familles thérapeutiques s'oriente la R&D des majors mondiales de la pharmacie ?
L’oncologie reste sans conteste le premier domaine de recherche international. La découverte de gène de susceptibilité dans de nombreux cancers, et notamment dans le cancer du sein ou celui du colon, a ouvert un champ de recherche considérable. Une dizaine de mutations génétiques sont actuellement systématiquement étudiées dans l’espoir de trouver des traitements qui neutralisent leurs effets oncogènes. Le très vaste champ des maladies auto-immunes (NDLR : polyarthrite, spondylarthrite, maladie de Crohn, etc.) reste également un domaine attractif de même que les maladies virales avec l’apparition récente de médicaments susceptibles d’éradiquer le virus de l’hépatite C. Il existe également une recherche importante dans le domaine des vaccins avec l’apparition de nouveaux concepts et de nouvelles techniques de production utilisant le génie génétique. En revanche, peu de recherche en antibiothérapie, faute sans doute de connaissances scientifiques nouvelles, même si le besoin de nouveaux produits reste important.
Les stratégies « caméléon »
Les « big pharma » redessinent la géopolitique du médicament
La plupart des pays développés se sont engagés dans une politique de réduction des dépenses de santé et dans la guerre contre la surconsommation de la santé. Les dépenses liées au médicament sont souvent les premières visées par les politiques de maîtrise budgétaire.
En réponse, les groupes pharmaceutiques ont déployé plusieurs stratégies pour s’adapter. La spécialisation dans leur domaine d’excellence est une d’entre elles. GSK a, par exemple, surpris tout le monde en abandonnant la cancérologie, un domaine en croissance, pour se spécialiser dans les vaccins et les médicaments sans ordonnance où le groupe estime avoir plus de chance de succès à l’échelle mondiale, observe le Pr. Claude Le Pen. Novartis, en revanche, s’est orienté vers la cancérologie se jugeant capable de construire une position de leader mondial.
Une autre stratégie est l’innovation et le développement technologique dans les sciences du vivant et de la biotechnologie. Le rachat réussi de la firme américaine Genzyme par Sanofi entre dans ce cadre. Une troisième stratégie – qui n’est pas jouée par tout le monde – est la présence sur les marchés les plus dynamiques notamment en Chine et en Asie du Sud-Est. Mais ce sont des marchés difficiles avec une concurrence des firmes locales et des contextes réglementaires non stabilisés.
Propos recueillis par Abashi SHAMAMBA
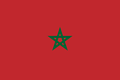 Santé Maghreb au Maroc
Santé Maghreb au Maroc![]() APIDPM © Copyright 2000-2026 - Tous droits réservés. Site réalisé et développé par APIDPM Santé tropicale.
APIDPM © Copyright 2000-2026 - Tous droits réservés. Site réalisé et développé par APIDPM Santé tropicale.