
Accès à la rubrique « Autogestion de la santé »
Consultez les mentions légales (RCP) des médicaments disponibles dans votre pays
![]() Médecine d'Afrique Noire
Médecine d'Afrique Noire
Consulter la revue
![]() Médecine du Maghreb
Médecine du Maghreb
Consulter la revue
![]() Odonto-Stomatologie Tropicale
Odonto-Stomatologie Tropicale
Consulter la revue
Restez informés : recevez, chaque jeudi, la lettre d'informations de Santé Maghreb.
Accueil > Santé Maghreb au Maroc > Revue de presse
Le matin | Maroc | 13/11/2013
Tel est le quotidien de cette mère de famille atteinte du diabète de type 1 depuis plus de 20 ans. «Contrairement à celui de type 2, dit gras ou de la maturité, le diabète de type 1 n’est pas dû au mode de vie (et à l’obésité), mais à la destruction de cellules du pancréas produisant l’insuline. Les globules blancs de notre système immunitaire (normalement chargés de traquer et d’éliminer les corps étrangers : virus, bactéries, parasites…) en sont les responsables, s’attaquant à notre propre organisme de façon autodestructrice ! D’où le terme de maladie auto-immune qui lui est donnée», explique le Dr Khadija Moussayer, présidente de l’Association marocaine des maladies auto-immunes (AMMAIS). «Ses premières manifestations souvent brutales (soif excessive, mictions très fréquentes, fatigue, perte de poids, nausées) sont le signe d’une forte hyperglycémie dans le sang aux effets potentiellement graves, allant jusqu’au coma», poursuit-elle.
Le contrôle du diabète s’effectue à l’aide d’un glucomètre ou d’une simple bandelette urinaire trempée dans les urines. Ainsi le patient pourra déterminer son taux de sucre dans le sang. Ce taux dans l’organisme est normalement d’environ 1 gramme par litre, soit 5 grammes au total (l’équivalent d’un morceau de sucre). Mais dans la journée, ce n’est pas l’équivalent d’un morceau de sucre que vous mangez, mais de plusieurs dizaines ! Heureusement, l’insuline, hormone hypoglycémiante, se charge de faire rentrer le sucre dans les cellules pour faire baisser la quantité de sucre dans le sang. Selon les spécialistes, on commence à parler de diabète lorsque le taux de sucre dans le sang dépasse 1,26 g/l à jeun. Au-delà de ce taux, nous sommes en hyperglycémie ; en dessous, en hypoglycémie. «Il n'y a alors qu'une solution : les injections d'insuline qui devront se poursuivre toute la vie. Cette hormone a pour fonctions d’assurer l’utilisation du glucose par les cellules de l’organisme pour ses dépenses en énergie et de réguler la quantité de sucre dans le sang», affirme notre spécialiste en médecine interne.
Son évolution se traduit de façon quasi inéluctable au bout de 15 à 20 ans. En effet, le diabète est une maladie silencieuse qui peut se révéler des années plus tard lors de graves complications qui touchent d’abord les petits vaisseaux sanguins, puis la rétine (la rétinopathie diabétique est la première cause de cécité chez les moins de 60 ans), les nerfs (suppression des réflexes, diminution de la perception des sensations au toucher), ou encore les reins (albumine dans les urines). «Ce que l’on sait moins, c’est que ce diabète juvénile concerne plus de 10% des diabétiques, qu’il progresse de près de 4% chaque année dans le monde et frappe de plus en plus les enfants en bas âge (entre 0 et 4 ans). Le Maroc n’est pas épargné puisque quelque 100 000 enfants seraient déjà touchés», se désole le Dr Khadija Moussayer.
Ce phénomène s’explique par une prédisposition génétique d’une part. «On observe plus fréquemment que la normale une transmission parents-enfants ou grands-parents-enfants», a-t-elle ajouté. D’autre part, les facteurs environnementaux comme la pollution peuvent en être la cause. En effet, selon la même source, il y aurait plus de 100 000 produits chimiques présents dans l’alimentation, l’eau, l’air, le sol ou à l’intérieur de nos maisons (pesticides, nitrates, métaux lourds, particules fines et dioxyde d’azote dégagés par les automobiles…) Ensuite, des bactéries ou des virus exerceraient une toxicité à l’encontre des cellules productrices d’insuline. Un apport insuffisant en vitamine D augmenterait également ce risque.
Enfin, l’excès d’hygiène est de plus en plus incriminé. La propreté a permis de mieux nous protéger des infections et de mettre fin à la forte mortalité infantile des siècles précédents. Son excès empêche maintenant le système immunitaire d’apprendre à reconnaître ses vrais ennemis. Désorienté, il s’attaque par erreur à notre corps. «La solution serait de permettre aux bébés et aux jeunes enfants de se “salir un peu” pour éduquer les défenses de leur organisme», confie la spécialiste. Des études récentes viennent conforter indirectement cette thèse en montrant que le risque de diabète de type 1 est accru chez les bébés nés par césarienne : elle les empêche en effet d’avoir un contact initial avec la flore bactérienne des muqueuses maternelles, alors que celle-ci est bénéfique ensuite à la constitution d’une flore intestinale variée pour les nouveau-nés.
Des pistes prometteuses !
En 2013, des chercheurs sont parvenus à transformer chez des souris certaines cellules du pancréas en cellules, celles qui produisent l’insuline. Ils étudient désormais les moyens de reproduire ce processus chez l’homme à l’aide de médicaments. Par ailleurs, d’autres scientifiques mettent au point des nanoparticules injectables dans le corps et capables, à la fois et ce pendant une semaine, de détecter les niveaux de glucose dans le sang et d’émettre, si besoin est, les quantités d’insuline nécessaires à une glycémie normale. Lorsqu’on sait qu’un diabétique doit s’injecter de l’insuline plusieurs fois par jour, on mesure le progrès que cela apporterait. De plus, cette nouvelle «insuline intelligente» éviterait pratiquement toutes les conséquences nuisibles de la maladie sur l’organisme (en supprimant l’alternance des périodes d’hypo et d’hyper glycémies préjudiciables aux vaisseaux sanguins). Enfin, une étude, publiée en juin de cette année, a montré que l’apparition future du diabète de type 1 se signale déjà chez plus de 80% des enfants concernés par la présence d’anticorps dirigés contre les cellules productrices d’insuline : ce type d’examen pourrait permettre au moins aux médecins de freiner sa survenue à défaut de l’empêcher.
Priscilla Maingre
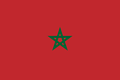 Santé Maghreb au Maroc
Santé Maghreb au Maroc![]() APIDPM © Copyright 2000-2025 - Tous droits réservés. Site réalisé et développé par APIDPM Santé tropicale.
APIDPM © Copyright 2000-2025 - Tous droits réservés. Site réalisé et développé par APIDPM Santé tropicale.